Participation électorale des étrangers en Belgique : une dimension oubliée de l’intégration ?
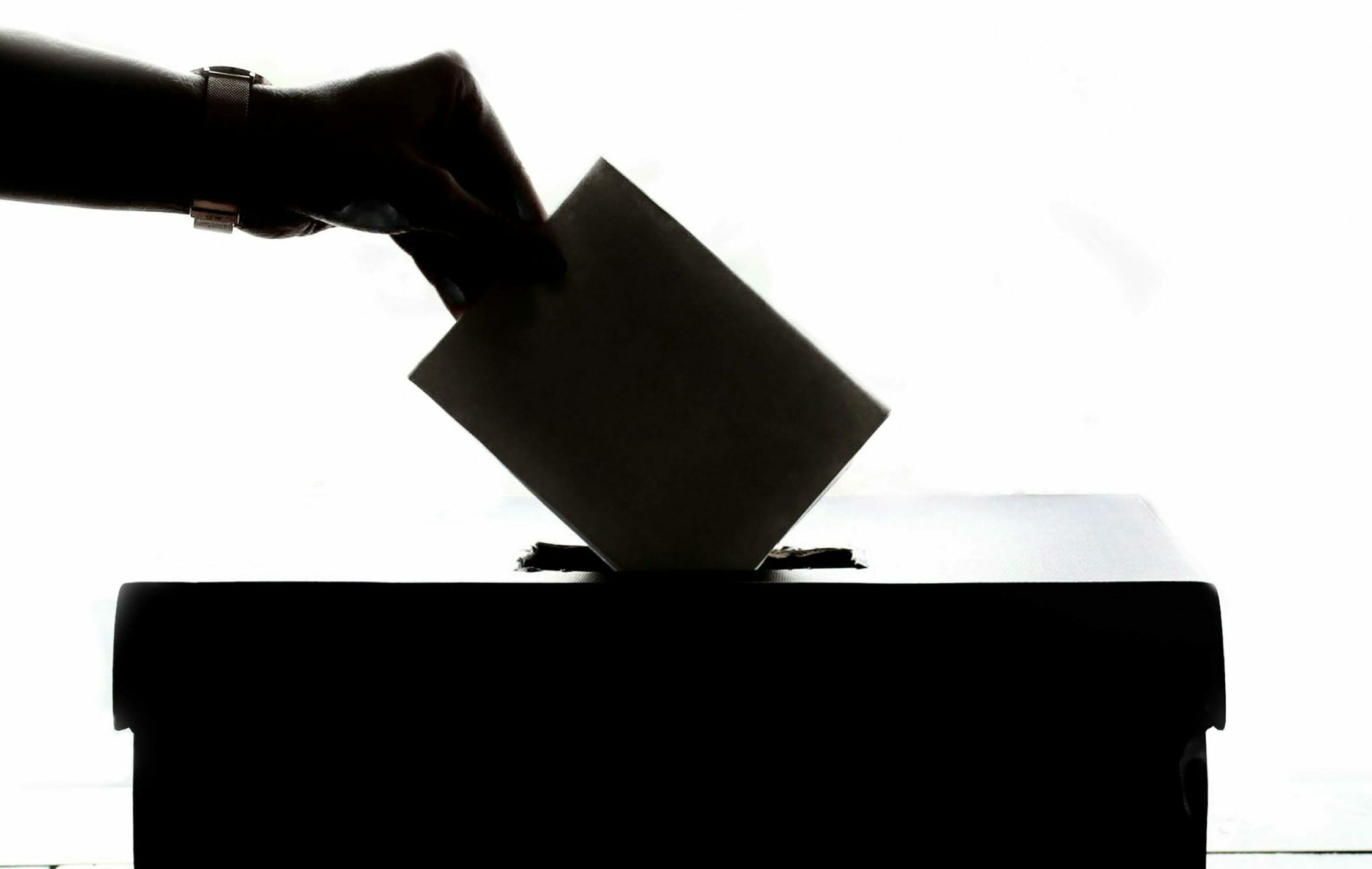
Ural Manço
© Une analyse de l’IRFAM, Liège, 2025.
Pour citer cette analyse
Ural Manço, « Participation électorale des étrangers en Belgique: une dimension oubliée de l’intégration?», Analyses de l’IRFAM, n°2, 2025.
Cette analyse a été éditée par Christina Cerfontaine
Voir ou télécharger au format PDF ![]()
Le droit de vote constitue la pierre angulaire de la citoyenneté dans l’Union européenne (UE), incarnant les valeurs démocratiques et jouant un rôle central dans le gouvernement représentatif. Ce droit fondamental est essentiel à la vie politique, car il garantit l’expression de la volonté collective des citoyens. Depuis 1999, en Belgique, comme dans tous les pays de l’UE, les ressortissants des États membres peuvent voter et se présenter aux élections européennes. En 2004, ce droit est étendu aux élections communales. Pour en bénéficier, les citoyens européens âgés de plus de 18 ans, inscrits au registre des étrangers d’une commune belge, doivent s’inscrire sur les listes électorales pour chaque type de scrutin. Cette démarche peut s’effectuer en ligne, par courrier ou directement au guichet communal. Toutefois, bien que le vote soit obligatoire, l’inscription sur ces listes ne garantit pas la participation effective. Cette même année, le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales a été élargi aux ressortissants de pays tiers. Désormais, les étrangers majeurs non européens, domiciliés en Belgique depuis au moins cinq ans et inscrits au registre des étrangers d’une commune, peuvent participer aux élections locales à condition de s’inscrire sur les listes électorales et de signer une déclaration d’engagement à respecter la Constitution, les lois belges et la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette dernière exigence est perçue par certains comme stigmatisante, puisqu’elle ne s’applique qu’aux étrangers non européens et non aux citoyens de l’UE.
Historiquement, la naturalisation et l’acquisition de droits politiques en Europe étaient perçues comme le fruit d’une intégration réussie dans la société d’accueil. Toutefois, au cours des dernières décennies, cette perspective a évolué, les décideurs européens voyant désormais la participation politique des migrants comme un indicateur de développement et de qualité démocratiques (Russo et Huddleston, 2021). Ainsi, l’octroi de droits politiques aux immigrés non naturalisés repose sur l’idée que l’intégration passe par la participation et favoriserait leur inclusion sociale peu après leur installation dans leur nouveau pays. Or, si ce droit revêt une valeur symbolique indéniable, renforçant le sentiment d’appartenance et la représentation politique, d’après ces auteurs, les études empiriques ne mettent pas en évidence une corrélation significative entre cet accès et l’intégration sociale ou politique, ni une accélération du processus de naturalisation ultérieure, et ce, quelles que soient les caractéristiques sociologiques des migrants.
Par ailleurs, l’extension du droit de vote et d’éligibilité aux ressortissants étrangers remet en question certaines conceptions traditionnelles de la citoyenneté, étroitement liée à la nationalité. Ce processus met en évidence les tensions entre le principe de résidence, qui sous-tend l’octroi du droit de vote aux personnes vivant sur un territoire, et celui de citoyenneté nationale, qui se fonde sur le principe du « droit du sang » (Szulecki, 2021). Par exemple, les résidents européens expatriés conservent généralement le droit de voter dans leur pays d’origine, malgré des liens parfois distants, tandis qu’ils sont souvent privés de ce droit dans leur pays de résidence. Cette situation illustre la transnationalisation croissante des droits politiques, un phénomène qui reflète les nouvelles réalités de la mobilité humaine et les défis posés aux États-nations. Ces évolutions soulèvent des questions fondamentales sur la nature du lien entre l’individu et la communauté politique, ainsi que sur les modalités de représentations démocratiques à l’ère de la mondialisation.
Pourtant, la mise en œuvre effective de ces droits se heurte à des obstacles concrets. En effet, dans la plupart des États membres de l’UE, plusieurs barrières entravent l’exercice de ce droit. Parmi celles-ci, on peut citer le manque d’information sur les modalités d’inscription, la complexité des procédures administratives, les difficultés liées aux barrières linguistiques, ainsi qu’une application parfois inégale de ces droits par les autorités locales. Ces obstacles témoignent de la nécessité de mettre en place des mesures spécifiques pour faciliter l’accès au vote des étrangers et garantir leur pleine participation à la vie démocratique (Strudel et coll., 2023).
En Belgique, 1 065 506 étrangers avaient le droit de voter pour les élections communales du 13 octobre 2024. Toutefois, seulement 15 % d’entre eux se sont inscrits sur les listes. Les données révèlent que les non-Européens s’inscrivent moins fréquemment que les Européens, avec des taux d’inscription plus élevés en Wallonie où un électeur potentiel sur quatre est inscrit. Néanmoins, même parmi les Européens, le taux d’inscriptions reste faible. Par exemple, l’étude de la campagne VoteBrussels menée dès 2018 visant à encourager l’inscription d’électeurs étrangers européens à Bruxelles a entraîné une augmentation de 4500 inscrits, portant le total à 41 251 inscrits en 2024 (11 % d’augmentation entre deux élections). Ce résultat encourageant ne cache pas que, malgré les droits électoraux acquis, les étrangers en Belgique, comme ailleurs en Europe, s’inscrivent peu sur les listes électorales (Russo et Huddleston, 2021).
Dans cette analyse, l’IRFAM s’efforce de décrire le comportement politique des électrices et électeurs étrangers européens et non européens dans l’UE et singulièrement en Belgique. L’objectif est de mieux comprendre la participation électorale des personnes étrangères et de contribuer à imaginer des initiatives qui pourraient réduire l’écart de participation électorale entre citoyens natifs ou non : une question d’importance dans un contexte planétaire qui voit la montée d’une expression politique conservatrice et identitaire.
Le comportement politique des électeurs étrangers européens et non européens
Notre connaissance des motivations des migrants à voter ou des raisons de leur abstention demeure limitée (Yılmaz, 2023). Quel que soit leur pays d’origine, les électeurs étrangers participent moins fréquemment aux élections européennes et communales que les électeurs nationaux. Un rapport récent sur l’inclusion politique des étrangers au Luxembourg indique que les migrants intra-européens ou de pays tiers ne restent souvent que quelques années dans leur pays d’accueil, généralement le temps d’un contrat de travail (CEFIS, 2024). Cette présence temporaire limite leur connaissance de la politique locale et des procédures, d’autant plus que les élections européennes leur paraissent déconnectées de leurs préoccupations quotidiennes (les questions d’emploi, d’éducation, de droits sociaux, de santé ou de logement). Ce sentiment de déconnexion est renforcé par des expériences de discrimination et une impression d’être instrumentalisés par les partis politiques, qui ne s’intéressent à leurs votes que pendant les campagnes électorales. Cette situation explique en grande partie leur réticence à s’inscrire sur les listes électorales.
Ainsi, beaucoup de migrants se sentent vivre dans une réalité parallèle, physiquement présents dans le pays d’accueil, mais mentalement ancrés dans leur pays d’origine. Ces résidents étrangers expriment souvent de la frustration face à l’absence du droit de vote aux élections législatives, qu’ils considèrent comme un moyen potentiel d’intégration sociale. Alors que le droit de vote aux élections communales et européennes, qui leur est accordé, est perçu comme une compensation insignifiante pour certains. D’autres, au contraire, estiment ne pas avoir suffisamment de légitimité pour être considérés comme des citoyens à part entière dans la société d’accueil. Ces attitudes opposées suggèrent que la non-participation massive des étrangers aux élections communales et européennes se trouverait dans le sentiment de légitimité ou d’illégitimité citoyenne, liée à l’expérience vécue et aux obstacles rencontrés lors de la socialisation au pays d’installation.
Les recherches récentes sur le comportement électoral des migrants ont mis en évidence un certain nombre de facteurs sociopolitiques qui influencent la participation aux élections municipales et européennes. L’infographie ci-dessous illustre ces dynamiques en montrant, par exemple, que les personnes âgées votent davantage que les jeunes, que les femmes participent plus fréquemment que les hommes, et que le niveau d’éducation joue un rôle déterminant, avec une mobilisation accrue chez les diplômés de l’enseignement supérieur. On y observe également que des facteurs comme la durée de résidence, l’exposition aux médias ou la confiance dans les institutions du pays d’accueil renforcent l’engagement politique. Ces indicateurs offrent un aperçu des multiples dimensions influençant la participation électorale et qui sont autant de dimensions sur lesquelles l’éducation permanente peut avoir un impact.
Facteurs sociopolitiques qui influencent positivement la participation aux élections

Sources des données : Szulecki, 2021 ; Strudel et coll., 2023 ; Yılmaz, 2023.
Comprendre la participation électorale des personnes étrangères
Deux approches théoriques permettent d’expliquer les déterminants du comportement électoral des résidents étrangers : la théorie de la transposition et celle de l’exposition du comportement électoral. Selon le premier point de vue, les migrants tendent à reproduire, dans leur pays d’accueil, les conduites électorales qu’ils avaient adoptées dans leur pays d’origine. Ainsi, les migrants issus de pays dotés d’une culture politique démocratique, où la tenue d’élections libres est courante et le droit de vote obligatoire, participent plus fréquemment aux élections dans leur pays d’installation que ceux provenant de régimes autoritaires. De plus, ceux qui proviennent de pays avec une participation électorale traditionnellement élevée votent aussi plus fréquemment dans le pays d’immigration. Toutefois, cette transposition d’habitudes électorales concerne principalement les migrants d’âge moyen ou avancé, car elle nécessite une expérience préalable significative du vote avant la migration (Strudel et coll., 2023).
La théorie de l’exposition postule, quant à elle, qu’une plus longue durée de résidence dans le pays d’accueil est corrélée avec une participation électorale plus élevée. Cela s’explique par une adaptation progressive des attitudes et comportements du migrant au contexte sociopolitique local, facilitée par des interactions avec les institutions, les individus et les valeurs du pays d’installation (Yılmaz, 2023). Par ailleurs, l’implication des migrants dans des associations ou des communautés informelles (de travail, de voisinage ou d’amitié) renforce leur propension à participer à des actions politiques, y compris le vote, car cette appartenance favorise la circulation de l’information politique et incite à l’action. Enfin, une forte densité de population migrante dans une zone donnée stimule également la participation des résidents étrangers d’une même origine, en raison de l’effet mobilisateur des réseaux sociaux et associatifs.
Par ailleurs, certaines études (Sciarini et Maye, 2020) postulent un effet de « contagion » : l’octroi du droit de vote aux migrants non naturalisés peut entraîner une augmentation du taux de participation électorale des citoyens natifs ou naturalisés. Cette contagion peut être à double sens : une corrélation est en effet observée entre les taux de participation des résidents autochtones et ceux des résidents étrangers. Par exemple, dans les municipalités où la participation électorale des nationaux est faible, celle des étrangers tend également à être basse.
Réduire l’écart de participation électorale entre citoyens natifs et électeurs étrangers
Dans l’UE, les politiques favorisant l’intégration politique des migrants se répartissent en trois catégories. La première concerne l’accès à la citoyenneté, qui inclut le droit de vote aux élections locales et européennes, ainsi que des procédures simplifiées de naturalisation, parfois conditionnée par la réussite de tests de citoyenneté. La deuxième vise à promouvoir l’égalité et la diversité en intégrant les personnes d’origine étrangère dans les institutions publiques et les organismes civils, tout en luttant activement contre la discrimination, la stigmatisation et le racisme. Enfin, la troisième catégorie regroupe les politiques sociales d’intégration, axées principalement sur l’emploi et le logement.
Cette inclusion politique doit être réalisée à deux niveaux complémentaires. D’une part, au niveau institutionnel, les instances législatives ont la responsabilité de définir le cadre juridique pour le droit de vote des résidents étrangers, en déterminant les conditions d’éligibilité, les modalités d’inscriptions et les mécanismes qui facilitent la participation électorale. D’autre part, au niveau de la sensibilisation, les collectivités locales, les partis politiques et la société civile jouent un rôle clé dans la mobilisation des électeurs étrangers. Pour être réellement efficaces, les campagnes de sensibilisation doivent s’adapter aux réalités et aux besoins spécifiques de ces publics.
Cependant, malgré les efforts entrepris, plusieurs obstacles subsistent. Les résidents étrangers, y compris ceux issus d’un pays membre de l’UE, se heurtent souvent à un manque d’informations précises sur les délais d’inscription et les procédures à suivre. Les sites internet des administrations publiques, souvent limités aux langues nationales et manquant de clarté (Yılmaz, 2023). Il serait utile de diffuser ces informations dans d’autres langues répandues ou dans la langue maternelle des principaux groupes d’électeurs potentiels, éventuellement dans la presse ou les réseaux sociaux qui concernent leurs communautés.
De surcroît, l’engagement des responsables associatifs ou militants politiques issus du même groupe ethnonational que les électeurs reste insuffisamment exploité dans de nombreux pays, alors que certaines initiatives ont montré des résultats encourageants. En Europe occidentale, des recherches-actions ont expérimenté des campagnes électorales non ciblées, menées par des démarcheurs formés, sans nécessairement partager l’origine des électeurs potentiels. Ces démarches, menées lors de périodes électorales, ont significativement accru la participation des résidents étrangers, sans annuler l’écart avec les nationaux (Pons et Liegey, 2019).
Ces différentes campagnes ont permis de tirer divers enseignements importants. Tout d’abord, il est apparu que les femmes sont plus susceptibles de s’inscrire sur les listes électorales à l’issue de ces campagnes de sensibilisation. Ce phénomène s’accompagne d’une corrélation entre la taille de la population d’une commune et le nombre d’inscriptions. Dans les grandes municipalités, le volume d’électeurs enregistrés est sensiblement plus élevé, illustrant un dynamisme propre aux zones densément peuplées. Cependant, cet élan ne s’étend pas uniformément à toutes les catégories de résidents. Dans les communes où la proportion de citoyens non européens est importante, le taux d’inscription des résidents étrangers tend à stagner, voire à décliner. Cette disparité met en lumière le rôle déterminant de l’attachement des étrangers à leur commune d’installation. Les municipalités qui prennent soin de développer des activités d’intégration et d’information en faveur des migrants enregistrent des niveaux de participation électorale supérieurs au sein de ces populations.
Un paradoxe émerge néanmoins dans certaines communautés immigrées. Malgré un faible taux d’inscription global, des individus membres de celles-ci franchissent le pas et se révèlent particulièrement engagés et politisés. Cette minorité motivée et agissante au sein d’une communauté non impliquée participe avec vigueur aux scrutins, témoignant d’une volonté de s’investir dans le processus démocratique malgré les obstacles rencontrés.
Conclusion
Bien que des avancées significatives aient été réalisées en matière d’inclusion électorale, l’écart de participation électorale entre citoyens natifs et électeurs d’origine étrangère reste grand dans tous les pays membres de l’UE. Cela témoigne de la persistance de barrières institutionnelles et linguistiques. En Belgique et ailleurs, l’inclusion politique des migrants ne se limite pas à l’exercice d’un droit, mais elle constitue un levier essentiel de l’intégration tout court.
Néanmoins, les recherches montrent que le droit de vote et d’éligibilité, bien que symboliquement important, n’a toujours pas l’impact escompté sur l’inclusion des migrants aux sociétés d’accueil. Cependant, les initiatives ciblées, telles que les campagnes de mobilisation électorale adaptées aux spécificités des populations concernées, démontrent qu’une approche plus inclusive et localisée peut contribuer à réduire les écarts de participation. Les enseignements tirés des actions participatives prouvent l’importance et l’efficacité de ce type d’approche ciblée et localisée pour favoriser l’inscription et la participation électorale des résidents étrangers.
L’enjeu reste donc de concilier l’octroi de droits politiques avec des mesures de sensibilisation adaptées pour garantir une participation électorale effective et renforcer l’inclusion politique. En effet, pour l’IRFAM, permettre aux résidents étrangers de participer pleinement à la vie citoyenne, notamment à travers le vote, favorise leur reconnaissance sociale et renforce leurs sentiments d’appartenance à la communauté locale. Cette dynamique reflète ce que Evelyn Nakano Glenn, professeur à l’Université de Californie et fondatrice d’un centre d’étude de l’intersectionnalité, appelle la « citoyenneté substantielle », une appartenance qui ne s’arrête pas à des droits formels, mais qui englobe une intégration active et une contribution significative à la société d’accueil.
Bibliographie
CEFIS (2024), « Les élections communales d’octobre 2023 », Recherche, Étude, Documentation, n° 24.
Pons V. et Liegey G. (2019), « Increasing the Electoral Participation of Immigrants : Experimental Evidence from France », The Economic Journal, v. 129, n° 617, p. 481-508.
Russo L. et Huddleston T. (2021), « Fostering the Political Participation of EU Non-national Citizens : The Case of Brussels », Journal of Contemporary European Research, v. 17, n° 4, p. 501-518.
Sciarini P. et Maye S. (2020), La participation des étrangers et étrangères aux élections communales dans le canton de Genève, Université de Genève.
Strudel S. et coll. (2023), « Échelles de citoyenneté en Europe : les logiques de l’inscription et de la participation électorales des citoyens européens aux élections municipales de 2020 à Paris », Journée d’étude Le vote transnational – Usages électoraux de la citoyenneté de l’Union européenne, Paris : Université Panthéon-Assas.
Szulecki K. (2021), « To Vote or not to Vote ? Migrant Electoral (Dis)Engagement in an Enlarged Europe », Migration Studies, v. 9, n° 3, p. 989-1010. Yılmaz S. (2023), Enhancing Electoral Participation of Mobile Voters in the European Parliament Elections 2024, Bruxelles : New Europeans Initiative.